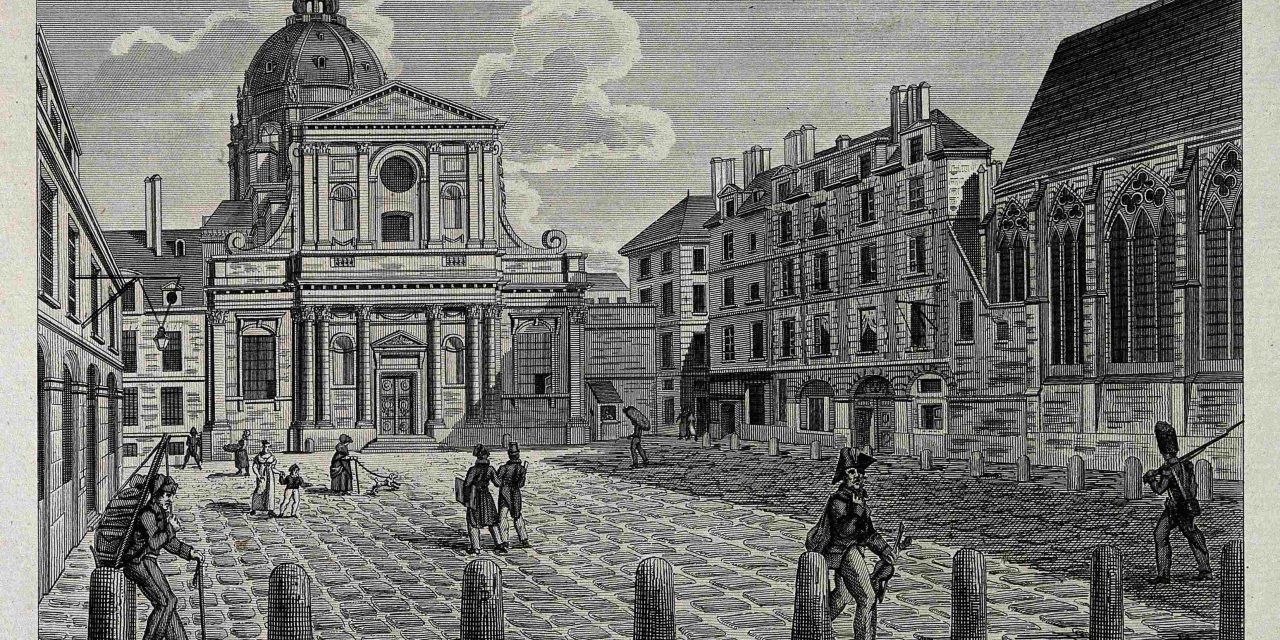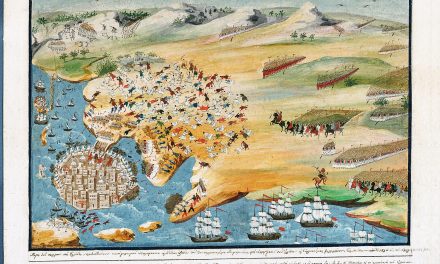La présence massive d’étudiants étrangers, dont nombreux grecs, dans les universités françaises depuis la fin du 19ème siècle s’inscrit dans un long processus d’internationalisation des études universitaires et de mouvements migratoires étudiants sur le continent européen. Comme souligné par Victor Karady (2002), les fondements du système universitaire occidental européen peuvent être rapportés tout d’abord aux réseaux et aux institutions de la soi-disant chrétienté latine de la fin du XIIème et des débuts du XIIIème siècle (avec les premières universités à Bologne, Paris, Oxford, Cambridge) ; l’ère de la modernité et des États-Nations donna lieu progressivement à des systèmes universitaires nationalisés, mais aussi, depuis le 19ème siècle, à une nouvelle forme de mobilité étudiante intra-européenne. Celle-ci se distinguait par rapport aux pérégrinations intra-régionales de l’époque classique ou de la Renaissance par son étendue et son ampleur, du fait que les étudiants étrangers dans les pays de l’Europe de l’Ouest à la fin du 19ème siècle provenaient massivement de l’Europe du Sud et de l’Est (Karady 2002). Ainsi, par exemple, de quelques centaines en 1870, le nombre des étudiants étrangers en France passera à 6.000 à la veille de la Première Guerre mondiale et à 17.000 au début des années 1930 (Manitakis 2000) ; 60% des étudiants étrangers dans les universités françaises en 1900 provenaient de l’Europe de l’Est et du Sud (avec une grande présence d’étudiants en provenance de l’Empire Russe, souvent de confession juive), tandis que leur nombre augmentera à 74% en 1911 (Karady 2002). Cette même dynamique s’affiche à l’époque dans la plupart des systèmes universitaires occidentaux européens.
Se « moderniser » en étudiant ailleurs
Cette massification de la mobilité étudiante en provenance de pays de la périphérie européenne, ainsi que les investissements des pays occidentaux dans leurs propres systèmes universitaires peuvent être placés dans un contexte historique particulier. La constitution de ce marché universitaire fait partie, entre autres, des efforts des grandes puissances géopolitiques d’accroître leur influence culturelle et exporter leur modèle idéologique par la voie de l’éducation des jeunes étudiants étrangers (et futures élites nationales potentielles), en parallèle à d’autres formes de diplomatie culturelle, telle que l’implantation d’instituts éducatifs à l’étranger, comme dans le cas de la Grèce (Kyprianos 2007, Manitakis 2000, Valenti 2003). La seconde moitié du 19ème siècle marque d’ailleurs l’intensification des concurrences géopolitiques sur fond de crises du capitalisme européen ; la rivalité franco-allemande figurera depuis en premier plan (Karady 2002). L’importation de savoirs technologiques et gouvernementaux de la part des pays européens à faible ou moyenne puissance était un facteur additionnel qui peut nous aider à comprendre la logique sous-tendant l’instauration graduelle de bourses nationales pour des études à l’étranger.
Cependant, la conjoncture de la seconde moitié du 19ème siècle semblait mettre aussi en relief une multitude de conditions sociales encadrant cette « expansion sans précédent »(Manitakis 2000) du nombre des étudiants étrangers au sein des universités françaises, allemandes, suisses, belges, austro-hongroises et italiennes. Victor Karady note tout d’abord le long processus de mystification dont les « études à l’étranger » avaient fait l’objet jusqu’à ce moment-là, en grande partie due à leur simple antériorité mais aussi dans une moindre mesure à des écarts structurels réels (Karady 2002). La seconde moitié du 19ème siècle coïncida aussi avec la consolidation de nouveaux systèmes éducatifs et, plus généralement la systématisation de l’enseignement secondaire en Europe de l’Est – sans pour autant la création parallèle d’institutions nationales universitaires; le manque de places pour ces nombreux bacheliers en demande d’études universitaires pourrait être un facteur explicatif. De même, l’émergence de nouvelles élites « postféodales », pour lesquelles les langues vivantes occidentales (surtout le français et l’allemand) revêtaient des multiples fonctions pratiques et symboliques, rendaient les études et les séjours en Europe de l’Ouest une étape indispensable quant à leurs propres stratégies de reproduction et de distinction sociale (Karady 2002, voir aussi Moulinier 2014).
La France en tant que destination privilégiée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale
Le cas français exemplifie les efforts étatiques pour attirer des étudiants étrangers (qui existaient déjà de fait) en plus grands nombres à partir des années 1880, en parallèle à l’amélioration des structures universitaires. Ainsi prit place, remarque Nicolas Manitakis, une campagne d’information avec la parution de guides d’informations pratiques et éducatifs destinés aux étudiants étrangers, la création de comités d’accueil pour ces étudiants dans chaque université française, des cours de langue française, mais ainsi que des mesures légales (par exemple, titres universitaires pour étudiants étrangers au lieu des grades étatiques jusqu’alors attribués normalement) visant à atténuer les pressions xénophobes d’une partie de l’opinion publique française à la fin du 19ème siècle (2000). En même temps, le cas français a connu un essor considérable du fait que les universités françaises accueillirent des femmes étudiantes dès les années 1870 (comme ce fut aussi le cas dans des universités suisses), tandis que des femmes étudiantes n’ont été admises dans des universités allemandes et austro-hongroises que vers la fin des années 1900 (Manitakis 2000).

Le statut de vainqueur de la France au lendemain de la Première Guerre mondiale rendra l’Hexagone la principale destination mondiale pour étudiants étrangers, devant l’Allemagne mais aussi les États-Unis (Kyprianos 2007) ; ces derniers commençaient déjà à s’afficher en tant que partie intégrante du marché international des études universitaires. De plus, la compétition éducative entre ces puissances s’exacerbe durant la période de l’entre-deux-guerres (Karady 2002). À noter la création d’une cité étudiante à Paris en 1925 – la Cité Internationale Universitaire, dans laquelle sera incluse la Fondation Hellénique (Manitakis 2016). Il semble qu’un grand nombre d’établissements universitaires en dehors de Paris, jusqu’alors en situation plutôt précaire, ont aussi profité à des degrés multiples de l’avènement de la population étudiante étrangère (Karady 2002). La France alors apparaît en tant que le pays le plus ouvert à l’accueil des étudiants étrangers ; situation qui changera graduellement tout au long des années 1930, avec les conséquences de la crise mondiale économique, la montée de la xénophobie en France et des nouvelles mesures restrictives subséquentes (Karady 2002).
Le cas grec : l’État lettré ?
La survalorisation des études universitaires au sein de l’État grec, officiellement créé en 1830, est un sujet qui a longtemps préoccupé l’historiographie, surtout par rapport au poids supposé de l’appareil étatique dans la société grecque (Kyprianos 2007). Cependant, en plaçant le cas grec dans le processus historique général susmentionné, ce qui se présente en tant que « particularité grecque » pourrait bel et bien s’agir plutôt d’une question de temporalité – l’État grec ayant été un des premiers États Nations créés aux confins de l’Europe et ayant démontré très tôt une dynamique qui s’afficherait plus tard dans le cas d’autres États aussi. Pour Pandelis Kyprianos, cette valorisation du savoir pourrait en même temps être due à l’idée courante à l’époque que les « Lumières néohelléniques » avaient constitué la force motrice du mouvement national grec, instituant ainsi idéologiquement le savoir intellectuel en tant que fondement sociétal central parmi les jeunes générations de l’État néo-hellène. En tout cas, la Grèce a eu le nombre le plus élevé d’étudiants d’Europe par rapport à sa population pour la période 1870-1890, même s’il faut noter la présence massive de Grecs de la diaspora dans l’institution universitaire du nouvel État, l’Université d’Athènes (Kyprianos 2007). À part les étudiants en Grèce, le nombre de Grecs (ressortissants du Royaume de Grèce ou Grecs de la diaspora) étudiant à l’étranger fut historiquement important. Déjà aux débuts du 19ème siècle on notait des centaines d’étudiants grecs dispersés en Italie, en France et en Allemagne (Kyprianos 2007). La création de l’Université d’Athènes changera relativement la donne, mais les études à l’étranger continueront à jouer un rôle important, surtout en ce qui concerne la formation des nouvelles élites de l’État grec. Pour la période 1870-1940, Pandelis Kyprianos estime que le nombre des étudiants grecs à l’étranger représentera 3 à 6% des étudiants en Grèce (2007). En ce qui concerne les élites politiques, un peu plus d’un tiers des ministres de la période 1843-1878 avaient effectué des études à l’étranger, tandis que ce chiffre passera à 50% pendant la période 1878-1910 (Sotiropoulos et Bourikos 2002).
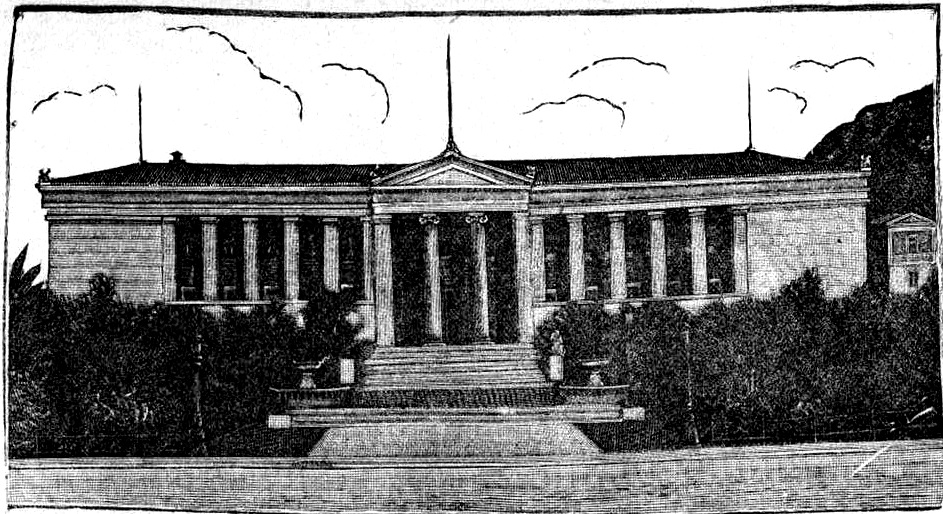
Il est intéressant de noter que malgré le prestige symbolique des études en Allemagne, ainsi que les liens politiques des royaumes de Grèce et d’Allemagne, la France figurera, du moins à partir de 1895, comme la principale destination étrangère pour les étudiants grecs. En effet, les étudiants grecs constitueront le troisième groupe d’étudiants étrangers le plus nombreux en France pour la période 1910-1930, derrière les Roumains et les Bulgares ; 106 étudiants en 1912, 372 en 1922, 474 en 1930 (Kyprianos 2007). La présence culturelle française sur le territoire grec depuis la moitié du 19ème siècle est un facteur qui peut nous aider à saisir la position privilégiée des universités françaises pour les étudiants grecs, en addition à leur montée en force mondiale générale (Kyprianos 2007).
Encore plus important peut s’avérer le contenu même des études : l’Allemagne semble toujours attirer tous ceux qui veulent étudier des sujets portant plus ou moins à des métiers d’État (enseignement, armée, magistrature, entre autres) et qui sont souvent boursiers de l’État grec, tandis que la France attire prioritairement ceux qui aspirent à des professions libérales (surtout droit et médecine). En retraçant les biographies de divers groupes sociaux, Kyprianos souligne que les détenteurs de postes au sommet de l’État grec ont principalement eu une expérience académique allemande (hommes d’État, académiciens, cadres publics – à l’exception des ingénieurs du secteur public), tandis que ceux qui ont étudié dans d’autres pays, surtout en France et en provenance de milieux familiaux relativement plus aisés, travaillaient plutôt dans le secteur privé. Même si numériquement plus restreinte et d’une étendue plus limitée, l’influence allemande parmi les élites grecques aura un poids particulier et une durée remarquable jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (Kyprianos 2007).
Les nouveaux enjeux de l’Après-guerre
Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Grèce a signalé l’effacement symbolique – inévitable – de la présence culturelle allemande (et italienne), ainsi que, dans certains cas, toute affiliation académique étrangère douteuse. Force est de noter, comme remarque Nicolas Manitakis, que des académiciens ayant effectué des études en Allemagne dans l’entre-deux-guerres tenteront de se reconvertir académiquement et linguistiquement en effectuant des courts séjours éducatifs dans des pays anglophones (Manitakis 2009). En effet, cette période marque la dominance croissante du système universitaire anglo-saxon (principalement Royaume Uni et États-Unis), parallèlement à la persistance du système français. Ces développements coïncident avec des restructurations géopolitiques, qui, dans le cas grec, se déroulent parallèlement à l’avènement de la Guerre Civile (qui, entre autres, signifie très tôt la cessation de tout échange éducatif gréco-soviétique officiel ; Manitakis 2009). Dans ce nouveau contexte, prendra lieu une compétition entre la France et les pays anglo-saxons pour attirer des étudiants grecs par la voie d’octroi de bourses étudiantes. Dans le cas des bourses britanniques et étatsuniennes, leur allocation reflète la coopération intime entre autorités grecques officielles de la période de la Guerre civile grecque et gouvernements britanniques et américains ; au contraire, dans le cas français, du moins dans la première phase de l’allocation des bourses (1945 et la génération des boursiers du « Mataroa »), il semble que l’appareil de la diplomatie culturelle française a retenu son autonomie à l’encontre des autorités grecques, reflétant ainsi la position ambigüe de l’État français par rapport à la Guerre Civile grecque (les communistes français faisaient d’ailleurs partie des gouvernements en France jusqu’en 1947), mais aussi l’apport personnel des membres de l’Institut Français d’Athènes et surtout celui d’Octave Merlier (Flitouris 2005, Manitakis 2009).
En tout cas, il semble que le Royaume Uni et les États-Unis se sont graduellement constitués en nouvelles destinations privilégiées pour des études à l’étranger, un changement qui sera de plus en plus visible à partir des années 1950 et 1960 dans les cercles technocratiques et académiques grecs (Manitakis 2009). Comme souligné par Dimitris Sotiropoulos et Dimitris Bourikos (2002), la plupart des ministres des gouvernements de la période jusqu’en 1967 ayant étudié à l’étranger avaient effectué leurs études en France et, dans une moindre mesure, en Allemagne. Néanmoins, la majorité des ministres des gouvernements dictatoriaux de 1967-1974 ayant étudié à l’étranger avaient effectué leurs études aux États-Unis (Sotiropoulos et Bourikos 2002). Le retour de la démocratie en 1974 signifia la relative prépondérance des ministres ayant effectué des études au Royaume Uni (parmi ceux ayant étudié à l’étranger). Mais plus généralement, comme soulignent Sotiropoulos et Bourikos, la période 1974-2001 signifia aussi une baisse totale du nombre des ministres ayant effectué des études à l’étranger.
Du point de vue sociologique, Nikos Panayotopoulos met en relief les différentes trajectoires sociales et les aspects symboliques qui se cristallisaient dans les études dans le monde anglo-saxon (« monde des affaires ») et en France (« culture ») ; en même temps, il faudrait aussi tenir en compte les écarts sociaux qui conditionnaient des stratégies alternatives pour des étudiants grecs dans d’autres pays (par exemple, en Europe de l’Est) (Panayotopoulos 1998). Plus généralement, la période 1952-1986 marque l’augmentation graduelle du nombre des étudiants grecs à l’étranger, une tendance qui s’atténuera par la suite (Panayotopoulos 1998).
Les effets de la crise récente sur la mobilité étudiante grecque
Aujourd’hui, comme remarquent Panagiotis Kimourtzis et Pandelis Kyprianos, le nombre d’étudiants grecs à l’étranger représente 6-7% des étudiants en Grèce ; les étudiants grecs à l’étranger affichent des origines sociales plutôt aisées (2019). De plus, la crise économique semble avoir accentué cette polarisation sociale, en mettant en relief l’importance des ressources économiques individuelles (ou familiales) et posant ainsi des obstacles d’accès à l’étranger aux étudiants provenant de milieux plus défavorisés ou incitant ces derniers à s’orienter à des sujets d’études d’une manière de plus en plus utilitariste (Kimourtzis et Kyprianos 2019). Selon les statistiques de l’OCDE en 2012, 35.217 Grecs étudiaient dans des pays de l’OCDE (outre la Grèce) et la Grèce détenait ainsi désormais la 23ème place sur l’échelle mondiale de la mobilité étudiante pour 210 pays – sur une population d’étudiants migrants de 3.4 millions d’étudiants étrangers dans les pays de l’OCDE -, position nettement inférieure à la 4ème place de 2001, avec à cette époque 55.074 personnes sur une population étudiante migrante mondiale de 1.5 million ; 9 sur 10 étudiants grecs à l’étranger étudiaient dans des pays de l’Union Européenne, prioritairement au Royaume Uni, l’Allemagne, l’Italie, et la France, ces quatre pays regroupant 71,6% du total des étudiants grecs à l’étranger (Kimourtzis et Kyprianos 2019).

Cependant, les développements des dernières années dans la société grecque pourraient bel et bien avoir démontré les limites de l’idéal de l’enseignement supérieur (Kimourtzis et Kyprianos 2019), en entraînant un certain désenchantement quant à sa dynamique d’ascension sociale et de réussite économique, jadis considérées comme allant-de-soi. Il n’en reste que les études universitaires demeurent toujours un sujet social et politique d’actualité pressante, tant en Grèce qu’à l’étranger.
Dimitris Gkintidis | Grecehebdo.gr
D. G.