Gilles Ortlieb est traducteur, poète et écrivain. Né au Maroc en 1953, il fait sa scolarité en France, puis des études de Lettres classiques à la Sorbonne avant d’obliquer vers l’étude du grec moderne à l’Institut des langues orientales. En 1986 il se fixe à Luxembourg, où il travaillera longtemps comme traducteur pour l’Union européenne.
Son premier livre de proses est paru en 1991 aux éditions Le temps qu’il fait, et est suivi de nombreux autres ouvrages : récits, poèmes, essais (dont plusieurs dans la collection de J.-B. Pontalis, chez Gallimard) ou carnets (aux éditions Finitude, notamment). En 2018, deux récits (Ce qu’il reste de la beauté et Episkopi) extraits d’Et tout un tremblement sont traduits en grec par Eleanna Vlachou.
Traducteur infatigable de la littérature grecque vers le français (Constantin Cavafy, Georges Séféris, Mikhail Mitsákis, Thanassis Valtinos, Dionysios Solomos, Nikos Kavvadias etc), GreceHebdo* s’est entretenu avec Gilles Ortlieb à l’occasion de la parution de Journées. 1925-1944, premier volume de la traduction intégrale du journal de G. Séféris, couvrant la période de 1925 à 1944 (Editions Le Bruit du temps, 2021).
Vous êtes un passionné de la langue et la littérature grecques. Qu’est-ce qui vous a poussé vers la découverte de la Grèce et de sa langue ?
L’itinéraire ne doit pas être, a priori, très original… Chronologiquement, il y avait eu l’apprentissage du grec ancien, dans un lycée de la banlieue parisienne (et qui représentait déjà une forme de libération par rapport au latin, plus ‘militaire’…) Puis un tout premier voyage sur place, dans une île des Cyclades, au cours de l’été qui avait suivi un printemps agité (celui de mai 68), et que j’avais vécu comme une révélation : la langue, la lumière, les gens, tout cela – qui formait un tout, à l’époque salvateur – s’était imposé avec une sorte d’évidence solaire. Et comme une façon de mettre de la couleur sur les petites vignettes en noir en blanc qui accompagnaient l’édition Hachette, à la couverture vert pâle, de l’Odyssée que j’avais étudiée en classe. Avaient suivi un séjour au mont Athos, en plein hiver, d’autres voyages et d’autres découvertes, parallèlement à l’apprentissage du grec moderne que j’avais potassé dans la méthode Assimil, à bord d’un paquebot qui faisait alors le trajet Marseille-Le Pirée en deux jours et trois nuits.
Après quoi je m’étais inscrit aux Langues-Orientales, histoire d’approfondir la connaissance de cette langue qui offrait en somme une patrie d’adoption et la promesse d’une traversée sans fin, à travers notamment le cabotage de la traduction. Cette langue apprise sur le tard et en partie sur le tas aura donc d’abord été cela : une langue pour échapper, aux « dialogues des morts » des années de lycée aussi bien, sans doute, qu’à la langue dite maternelle. Même si celle-ci finit toujours, bien sûr, par nous rattraper. Il n’empêche, entre cet ailleurs saturé de signaux amis qui finit par délimiter un chez-soi d’autant plus confortable qu’on n’y est pas véritablement chez soi, et le pays d’origine auquel il est parfois indispensable de fausser compagnie, le mouvement de balancier mis en place n’est parfois pas très loin de ressembler à l’illustration géographique et pratique d’un mouvement perpétuel.

Parmi vos traductions figurent Constantin Cavafy, Georges Séféris, Mihaïl Mitsakis Thanassis Valtinos, Dionysios Solomos, Georges Ioannou, Zissimos Lorenzatos etc. Est-ce qu’il y a un auteur que vous aimez particulièrement ?
Parmi les auteurs que vous citez, il y en a deux (Lorentzatos et Ioannou) que je n’ai pas vraiment traduits : seulement des petits textes en revue. D’autres, en revanche, comme Mikhaïl Mitsakis ou Thanassis Valtinos, m’auront occupé beaucoup plus longtemps, mais ils en valaient aussi la peine. Mitsakis, que j’avais découvert par hasard, est un peu un cas-limite : auteur très prolixe mais sans œuvre (il n’a publié de son vivant qu’une mince plaquette, tous ses écrits étant éparpillés dans des journaux ou revues), d’une grande modernité dans ses thèmes et son écriture alors même qu’il pouvait être un adepte virtuose de la langue « katharevoussa » (voir son récit Un chercheur d’or), ayant connu un destin tragique puisqu’il a passé les dernières années de sa vie dans un asile psychiatrique à composer dans notre langue des poèmes plus qu’énigmatiques, il occupe une place très singulière dans la littérature grecque et représente pour moi une sorte d’épigone et de précurseur de plusieurs écrivains qui me sont très chers (Nerval, Walser, Bove…).
Parmi les vivants, Thanassis Valtinos est aussi un auteur que j’aime beaucoup, notamment pour ses nouvelles et ses textes brefs, qui parviennent à ressusciter tout un monde et parfois toute une époque en l’espace de quelques pages. On a là affaire à un style très sec, très dépouillé, et d’une grande efficacité narrative. Pour les autres auteurs cités, les « classiques » comme Cavafis ou Solomos (des cas-limites eux aussi, à leur manière), c’était évidemment le travail sur la langue qui a pris presque toute la place. Quant à Séféris… (voir ci-dessous !)

Quelles sont, à votre avis, les voies principales de publication de la littérature grecque vers le français ?
Je ne suis pas très au fait des canaux officiels, des programmes d’aide disponibles, etc., mais j’aurais tendance à penser qu’une voie non négligeable – à l’exception de la traduction du Suicidé de Mitsakis qui put bénéficier d’un soutien officiel en Grèce, ce fut, d’expérience, le cas pour tous les autres ouvrages traduits, parus en France – passe d’abord par l’enthousiasme du traducteur pour un texte ou pour une œuvre. À ce jour, rien ne m’est encore resté sur les bras, comme on dit. Car l’enthousiasme est facilement contagieux, qui peut « faire passer » un texte a priori difficile, comme La Femme de Zante ou Contre-courant de Valtinos, et aider à trouver une maison d’édition qui sera prête à l’héberger dans son catalogue. Cela dit, la traduction des Journées a été partiellement prise en charge par le CNL, et je ne désespère pas que l’éditeur du Bruit du temps, Antoine Jaccottet, puisse trouver plus tard ici, en Grèce, des soutiens susceptibles de parrainer la publication du deuxième et dernier tome à venir.
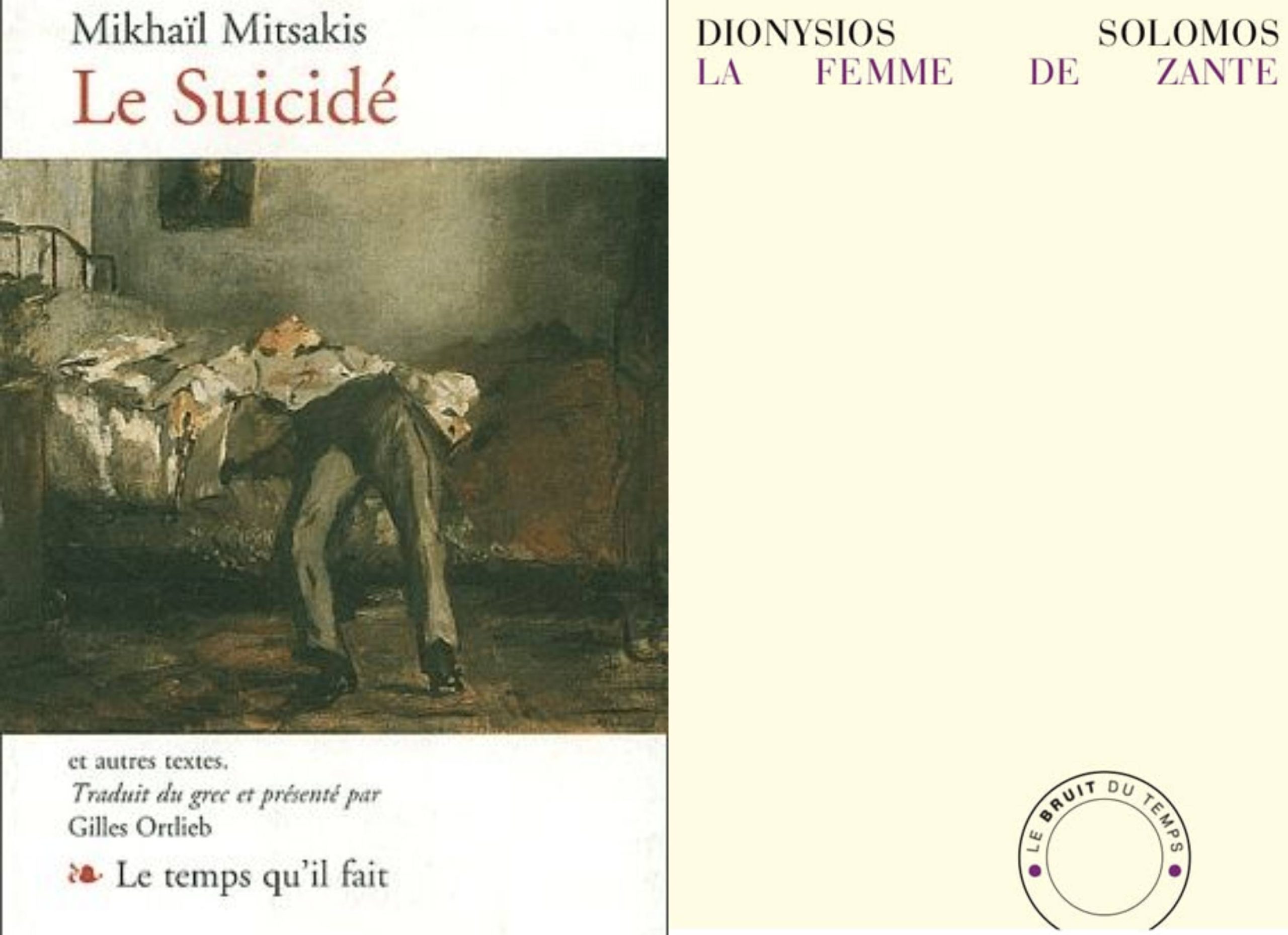
A l’occasion de la parution de Journées. 1925-1944 par Georges Séféris (Editions Le Bruit du temps, 2021), voudriez vous nous en parler en tant que traducteur de cet ouvrage majeur ?
Si je jette un regard rétrospectif sur ce travail, après ce long compagnonnage (de près de deux années) avec les versants les plus intimes de cet homme qui est surtout connu ici comme un poète rare et plutôt secret, j’ai un peu l’impression d’avoir été comme Jonas dans sa baleine… Il s’agit à tous égards d’un livre hors normes : tenu sans interruption entre février 1925, année où Georges Séfériadis, jeune diplômé en droit, retrouve la Grèce après un long séjour à l’étranger, et mai 1971, quelques mois avant sa mort, ce Journal offre un témoignage capital sur l’itinéraire intellectuel du diariste, mais aussi sur l’histoire de son pays pendant la période de l’entre-deux-guerres et, tout autant, sur la relation intense, écartelée, entre l’homme et le pays qu’il avait pour métier de représenter. Sur les neuf volumes de l’édition originale, les lecteurs français ne pouvaient jusqu’à présent avoir accès qu’au volume traduit par Lorand Gaspar (couvrant les années 1945-51 et désormais épuisé) ou à un choix d’extraits, par nature éclectique, réunis par Denis Kohler sous le titre Pages de Journal.
Terreau de son œuvre poétique, mais aussi d’essayiste, ce document sans équivalent en Grèce par son ampleur, nous permet de suivre l’auteur dans toutes les étapes de sa carrière diplomatique à Londres, en Albanie et en Grèce, mais aussi au Moyen-Orient où il accompagne le gouvernement en exil, et jusqu’en Afrique du Sud, avant son retour dans une Athènes ensanglantée par les événements de décembre 1944. Conçu « comme un outil et non comme une œuvre en soi », c’est aussi, bien sûr, le journal d’un itinéraire intime et l’atelier ou la chambre d’échos d’un poète à l’œuvre, où affleurent en permanence ses lectures du moment, éclairées par les « phares » qui l’auront aidé à se guider (Paul Valéry, Makriyannis, Cavafis, Le Gréco, T.S. Eliot, etc.) dans des années difficiles.

Ponctué de poèmes pour la plupart inédits, rapportant ses rencontres et amitiés avec de nombreux écrivains (André Gide, Lawrence Durrell, Henry Miller, etc.), cet outil – qui lui aura finalement permis, en ajustant son rapport au monde, de se trouver lui-même – apparaît bien, avec le recul, comme une œuvre en soi, à l’égal du Journal de Pavese ou de Kafka, des Choses vues d’Hugo ou du Zibaldone de Leopardi.
En attendant de traduire le deuxième tome, qui devrait être plus volumineux que le premier, j’ai au moins l’impression d’avoir pu approcher de près, par les yeux d’un témoin et acteur de tout premier plan, l’histoire pas moins tourmentée de la Grèce avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu’aux prémices de la guerre civile qui allait bientôt lacérer le pays. Pour ce qui est maintenant de la traduction proprement dite, j’ai pu vérifier, une fois de plus, combien on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise interprétation, voire d’un contre-sens, dans la pratique d’une langue qu’on croit pourtant bien connaître ou s’agissant de réalités qu’on croyait familières. Une leçon d’humilité, en somme.
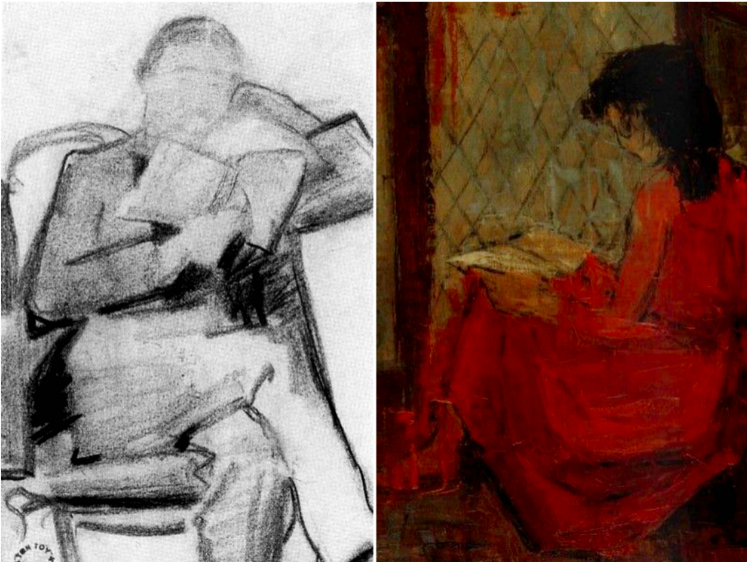
Dans ses journaux, Séféris exprime son oscillation entre la culture française et grecque ainsi qu’un sentiment d’exilé permanent. Également, dans votre poésie, nous rencontrons souvent le flâneur en quête de quelque chose de vague qui lui échappe. Quelle est votre relation avec l’exile et la nostalgie ?
Là, on change de registre… Il se trouve que, pour raisons professionnelles, j’ai aussi dû vivre longtemps à l’étranger et effectuer des tâches de bureau parfois pesantes, mais l’analogie s’arrête là : entre ce qui apparaît comme une véritable odyssée à l’échelle d’une vie, dans le cas de Séféris, si l’on tient compte de tous les postes diplomatiques qu’il a été amené à occuper dans de nombreux pays, et le sentiment du manque que l’on peut éprouver dans un pays limitrophe comme le Grand-Duché de Luxembourg, le fossé est quand même très large.
Quant à la flânerie, il s’agit là d’une occupation, si l’on peut dire, très distincte du sentiment d’exil – même si ce dernier peut l’encourager et l’alimenter dans des proportions qui quelquefois nous échappent. Les circonstances nous amenant ainsi à vivre dans des lieux, des villes que nous n’aurions sans doute jamais choisis, il reste malgré tout la ressource de regarder autour de soi, jusqu’à ce que cet « autour-de-soi » finisse par devenir, sinon transparent, du moins reconnaissable et familier. Affranchi, par imprégnation, de l’étranger. Quand bien même l’étranger est d’abord, et uniquement, celui qui se trouve là et observe. Séféris écrit quelque part dans son Journal : « Y a-t-il plus grande amertume que d’éprouver de la nostalgie pour le pays dans lequel tu vis ? » Je me demande s’il n’y a pas aussi une forme d’amertume à n’éprouver aucune nostalgie pour un pays dans lequel on a été contraint de vivre, « faute de mieux ».

D’après Georges Séféris, la prédominance de l’image néoclassique de la Grèce était ennuyante. Est-ce que ce stéréotype de réception persiste, selon vous ? Autrement dit, est-ce que l’image du pays est surtout définie autour des antithèses antiquité/modernité, est/ouest, encore aujourd’hui ?
Je repense à l’agacement de Séféris, lorsqu’il avait dû accompagner le président français Herriot, dans les années 20, et que celui-ci lui avait fait part de son désintérêt total pour la Grèce d’après le 3e siècle avant J.-C… On sait combien cette réaction l’avait choqué, et combien son œuvre de poète et d’essayiste n’aura finalement tendu qu’à cela : jeter une passerelle entre un passé parfois encombrant et un présent souvent étriqué. Comme entre un Occident accusant presque un surpoids culturel et un pays, le sien, à cet égard beaucoup plus démuni, mais dont l’héritage compensait très largement le dénuement. Pour ma part, je ne vois pas là matière à antithèse, plutôt des motifs d’émerveillement. Celui qu’on peut éprouver, par exemple, en tombant dans le Péloponnèse, au détour d’une route, sur des panneaux indiquant Némée, Lerne ou le lac Stymphale. Ou, à Ithaque, sur une boutique de cadeaux « Nausicaa », une boucherie « Eumée » ou un lavomatique « Polyphème »… Aucune solution de continuité, donc, pour moi, dans cette histoire si longue et si ancienne et qui remonte, comme la langue, à Homère et bien au-delà.

Votre livre Ce qu’il reste de la beauté (Rodakio, édition bilingue, 2018) exprime une sorte de quête pour la beauté dans la Grèce d’aujourd’hui. La beauté est-elle toujours une quête ?
C’est forcément une quête et – la plupart du temps, malheureusement – un travail… Ne serait-ce que pour en détacher tout ce qui pourrait venir la coloniser, la parasiter. La justesse dans l’expression est rarement donnée d’emblée, tout comme la bonne distance par rapport aux choses, ou par rapport à soi-même quand vient le moment de fixer, de noter quelques-unes de ces choses parmi celles qui se signalent à votre attention et semblent vous parler. À vouloir trop cadrer, ou encadrer, la beauté, on risque de la relativiser et, au bout du compte, l’amoindrir, et tout l’effort consiste donc, paradoxalement, à cumuler dans un premier temps pour mieux éliminer ensuite. On rejoint ainsi cette notion de « dépouillement » si chère à Séféris, de « corde tendue », d’ascèse au sens premier du mot, celui d’exercice. J’espère avoir plus ou moins répondu à votre question..? Car j’ai peur, en voulant me montrer trop bavard, de m’écarter d’autant de la vraie nature et d’une définition possible de la beauté. Ou de ce qu’il en reste…
* Interview accordée à Lina Syriopoulou et Magdalini Varoucha | GreceHebdo.gr
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA LITTERATURE GRECQUE | LIRE PLUS SUR GRECEHEBDO:
- GRECEHEBDO | Georges Seferis (1900-1971) | Le grand errant de la poésie grecque
- La littérature grecque contemporaine: Une introduction, Lettres | Littérature grecque en français
- GRECEHEBDO | Interview | Anne-Laure Brisac: « Le public français est heureux de découvrir une Grèce d’aujourd’hui » Interview | Socrates Kabouropoulos : La littérature grecque à l’étranger, le cas de la FranceINTERVIEW | Petros Markaris: la crise visitée par le roman policier, INTERVIEW | Vassilis Alexakis, entre Paris et Athènes, INTERVIEW | Christos Chryssopoulos et le mélange des genres, INTERVIEW | Desmos, une librairie hellénique au cœur de Paris, INTERVIEW | Rhéa Galanaki : « La littérature est l’art du déguisement par excellence », INTERVIEW | Thanassis Hatzopoulos – L’art est un réservoir sans fin de l’expression humaine
-
INTERVIEW Christos Ikonomou raconte le coût humain de la crise, INTERVIEW | Yannis Kiourtsakis: l’écriture et l’identité grecque entre tradition et modernité,INTERVIEW | Yiannis Makridakis : éloge de microsociétés insulaires égéennes, INTERVIEW | Loïc Marcou: un passionné de la littérature grecque, INTERVIEW | Ersi Sotiropoulos : le bref séjour de Cavafy à Paris | Prix Méditerranée du livre, INTERVIEW | Jeanne Roques-Tesson – Terres de sang de Dido Sotiriou est un ”livre monument” de la littérature grecque, INTERVIEW | Thanassis Valtinos: un grand montagnard de la Grèce profonde, INTERVIEW | Michel Volkovitch: la Grèce a un problème d’image.
-
Constantin Cavafy: sa vie et un voyage à Paris, La littérature grecque contemporaine: Ioanna Karystiani, Nikos Kazantzakis: un Ulysse contemporain,Nikos Kazantzakis : flânerie éternelle dans le monde, La littérature grecque contemporaine: Pavlos Matessis, Littérature grecque en français: Stratis Myrivillis, ‘’La Vie dans la tombe’’, Littérature grecque en français: Alexandros Papadiamantis, le saint des lettres grecques, Littérature grecque en français: Emmanouïl Roïdis, l’art de l’ironie au 19ème siècle, La littérature grecque contemporaine: Costas Taktsis, Littérature grecque en français : Stratis Tsirkas et la mémoire historique, La littérature grecque contemporaine: Vassilis Vassilikos, Littérature grecque en français: Elias Vénézis, Le Numéro 31328 ou la protestation contre la guerre, La littérature grecque contemporaine: Zyranna Zateli, pas comme les autres, Auteurs du XIX siècle- Jean Psichari: le père de la démotique
M.V.














