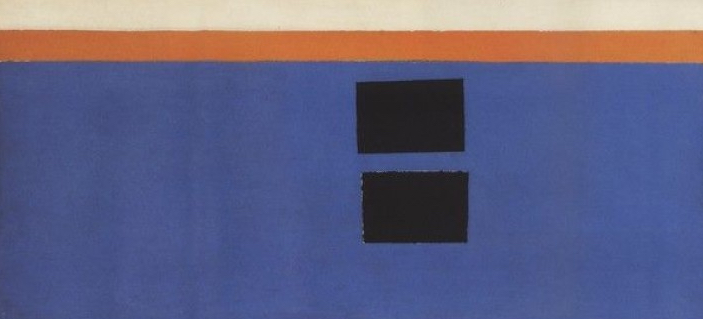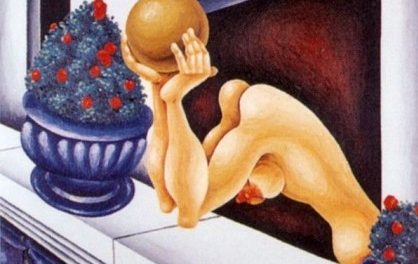Une pomme mûre éclaire la cuisine
et je trouve ton chemin.
Les corps immatures ont eux aussi leur vieillissement.
La plupart s’effeuillent.
Tes cheveux rouges,
un incendie dans le quartier.
Les verts ne sont pas encore arrivés.
L’horizon, un petit trait.
Mais après, quel gouffre, mon Dieu !
Le vent, le vent a tout emporté
et a laissé un résidu de mémoire,
une boue dans la tête.
Les magasins de mes rêves
sont toujours bien remplis de terre.
Ce n’est pas la faute du poème
si le fleuve ne passe pas
à travers ma maison.
La lune, pendue à ton col,
t’embrasse désespérément.
Alentour, fumée, voitures et tristesse.
Tu es tombé dans un vide d’homme.
Attache ta ceinture.
Dans la citerne de tes sanglots,
ajoute mon nom.
Des capsules de bière jetées dans
la cervelle de la vieille femme,
qui maintenant blanchit petit à petit et perd la tête.
Ta serviette de bain bleue, qui quand tu t’essuies
devient toute rouge.
Les dessins animés de la Camarde.
Quelle usure, aussi, cette éternité !
Quelle vermine.
Les fragments de la journée d’hier
m’ont touché au visage et m’ont laissé des marques.
Le ver dans le silence de la nuit
crée sa musique et son labyrinthe.
Les oiseaux plongeaient dans l’après-midi,
comme dans l’eau.
Ça leur plaisait de jouer avec le feu.
Le mort cirait ses chaussures.
Il lui restait encore beaucoup de chemin
sur des nuages rocailleux et pleins de poussière,
jusqu’à ce qu’il revienne sur terre
et qu’il se cache dans l’appentis du jardin.
Le placard disparaîtra, il deviendra poussière.
Mais pour le moment il est éternel,
il recèle tes habits.
Quand tu te bats avec le sommeil
et avec le lierre noir qui rampe sur ton corps
dans les petits matins.
Le paysage était effectivement triste.
Un vent soufflait du Sud, l’obscurité tombait
et tous regardaient à terre.
Quelque part il pleuvait et un enfant pleurait.
Un cheval remâchait le vent.
Pourtant au fond du paysage
retentissaient des vivats et des coups de feu.
La révolution arrivait
grondement de mer écarlate.
Un fruit a roulé dans la rue.
Il cherche de la terre,
pour pourrir en paix.
Incertaines les limites de cette nuit
où je t’attends.
Tout comme une montre s’arrête
et tu la démontes
pour trouver son secret.
La mie du temps.
Tu vois le néant
s’élever en fumée.
De cette maison sort une musique.
Elle monte comme de l’eau pour nous noyer.
Quelqu’un là-dedans joue avec les mots
dans l’obscurité. Il jette des osselets.
Tu laisses tes traces sur moi
et j’en suis tacheté.
C’est ainsi qu’ils me connaissent, au paradis.
La semi-obscurité dans la chapelle,
prune acide dans la lumière de l’Attique.
De la poussière tombe, quand grincent les poutres
du ciel.
Ça nous blanchit les cheveux.
Non que ce soit une catastrophe,
simplement les années passent.
Dans un coin de l’été,
le ver à soie mange la lumière
et fabrique de la soie pour la nuit.
La moitié de son visage creusait la lumière.
L’autre moitié était dans l’obscurité.
Acteur, il joue le même rôle toute sa vie.
Il est devenu classique. Lui-même se sent comme s’il allumait et éteignait
la lumière et il ferme les portes.
C’est ainsi qu’un jour il s’est figé.
Il a tout oublié.
La seule chose qu’il disait, comme un enfant perdu
sur le rivage : «je vais, je vais, quand je vais»
et il essayait de pleurer.