Theodoros Rakopoulos est anthropologue social et actuellement professeur agrégé à l’Université d’Oslo en Norvège. Il a effectué des études en Droit et Sciences Politique et a obtenu son doctorat en Anthropologie Sociale à l’Université de Goldsmiths à Londres. Ses recherches portent sur les coopératives agricoles « anti-mafia » en Sicile (2008-2009) et sur les mouvements alternatifs de distribution de nourriture en Grèce (2013-2016). Rakopoulos a aussi publié trois recueils de poésie et un recueil de nouvelles en grec.
À l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif « The Global life of austerity » (La vie globale de l’austérité) paru en juin 2018 aux éditions Berghahn sous sa direction, GrèceHebdo* a interviewé Theodoros Rakopoulos sur l’état de la recherche anthropologique aujourd’hui, le concept d’ « austérité », ainsi que les impasses des interprétations culturelles de la crise économique.
Un élément qui semble traverser votre recherche en Sicile et en Grèce est celui de la « solidarité », dans des conditions d’inégalité sociale de plus en plus rampante. Est-ce-que ce vocabulaire moral, qui inclut aussi des concepts comme celui de « dignité » et d’ « humanisme », fonctionne d’une manière complémentaire aux politiques d’austérité dominantes ou par contre s’oppose clairement à celles-ci ?
C’est une question très intéressante et cruciale. Les deux réponses sont valables : en fait, dans une époque où l’État providence est en état d’effondrement et du fait que ce concept relève, historiquement et conceptuellement, d’une dépendance institutionnelle, on se trouve devant une nouvelle problématique. En fait, il s’agit d’une relation de convergence entre les termes que vous avez mentionnés, ainsi que d’une relation entre les politiques d’austérité et les tendances qui s’y opposent. Bref, on a affaire à deux tendances en apparence contradictoires mais en effet entremêlées. D’un côté, on a bien sûr la solidarité et ses demandes dynamiques (voir économie solidaire, réseaux de soutien informels, etc.), qui s’articulent contre l’austérité. De l’autre côté, on a ces mêmes pratiques populaires de dignité et de solidarité entre soi qui se revêtent, involontairement et sans dol, de ce que Muehlebach et d’autres écrivains ont appelé « le moral néoliberal ». Je tiens à dire que souvent la solidarité est pratiquement entremêlée avec la dérégulation de l’État providence, même si les acteurs de la solidarité s’opposent à cette dérégulation. Cette conclusion provisoire est un constat très simple mais aussi difficile – et on a besoin de plus de recherche à l’égard de ce sujet. Pour ce qui est de la « dignité », comme le cas grec nous a récemment démontré, on devrait s’interroger sur la durabilité politique d’une telle demande. Le cas des mouvements sociaux qui ont mis en avant cette notion en Grèce et en Espagne montre que ce n’est pas vraiment le cas.
Les politiques d’austérité dominantes dans les économies développées d’aujourd’hui ont été longtemps analysées comme un produit de processus idéologique – et surtout en ayant comme point de référence le courant du « néolibéralisme ». De quelle façon l’ouvrage collectif que vous avez dirigé négocie-t-il ce schéma interprétatif ?
L’ouvrage collectif «The Global life of austerity» évite ce concept souvent trop usité et, disons aussi, un peu épuisé, tant dans l’introduction que dans les contributions à part. Il est vrai qu’en ce qui concerne le domaine des sciences sociales, il existe, depuis des décennies et même d’une intensité particulière ce dernier temps, ce que qu’on pourrait appeler, avec un peu d’humour et de taquinerie si vous me le permettez bien, une reductio ad neoliberalium : une réduction constante au Moloch du néolibéralisme qui –évidemment- nous commande, et qui d’un point de vue analytique sert de passe-partout théorique. Toutefois, à plusieurs reprises cette réduction perd sa dynamique analytique initiale (en effet, le néolibéralisme a des effets dévastateurs sur la cohésion sociale), parce qu’elle cesse de saisir la base du paradigme néolibéral en tant que relation dynamique, qui est imbriquée dans un axe d’analyse central et matériel, ce qu’on pourrait nommer la relation sociale entre travail et capital. Je me souviens de Alexis Tsipras à Londres en 2012, quand il avait parlé dans un amphithéâtre pendant une occasion officielle, et avait ouvert son discours avec une phrase d’inspiration foucauldienne, clairement écrite par un de ses collaborateurs : « le néolibéralisme est un système de pouvoir biopolitique ». Bien sûr que oui, mais est ce que c’est seulement ça ?
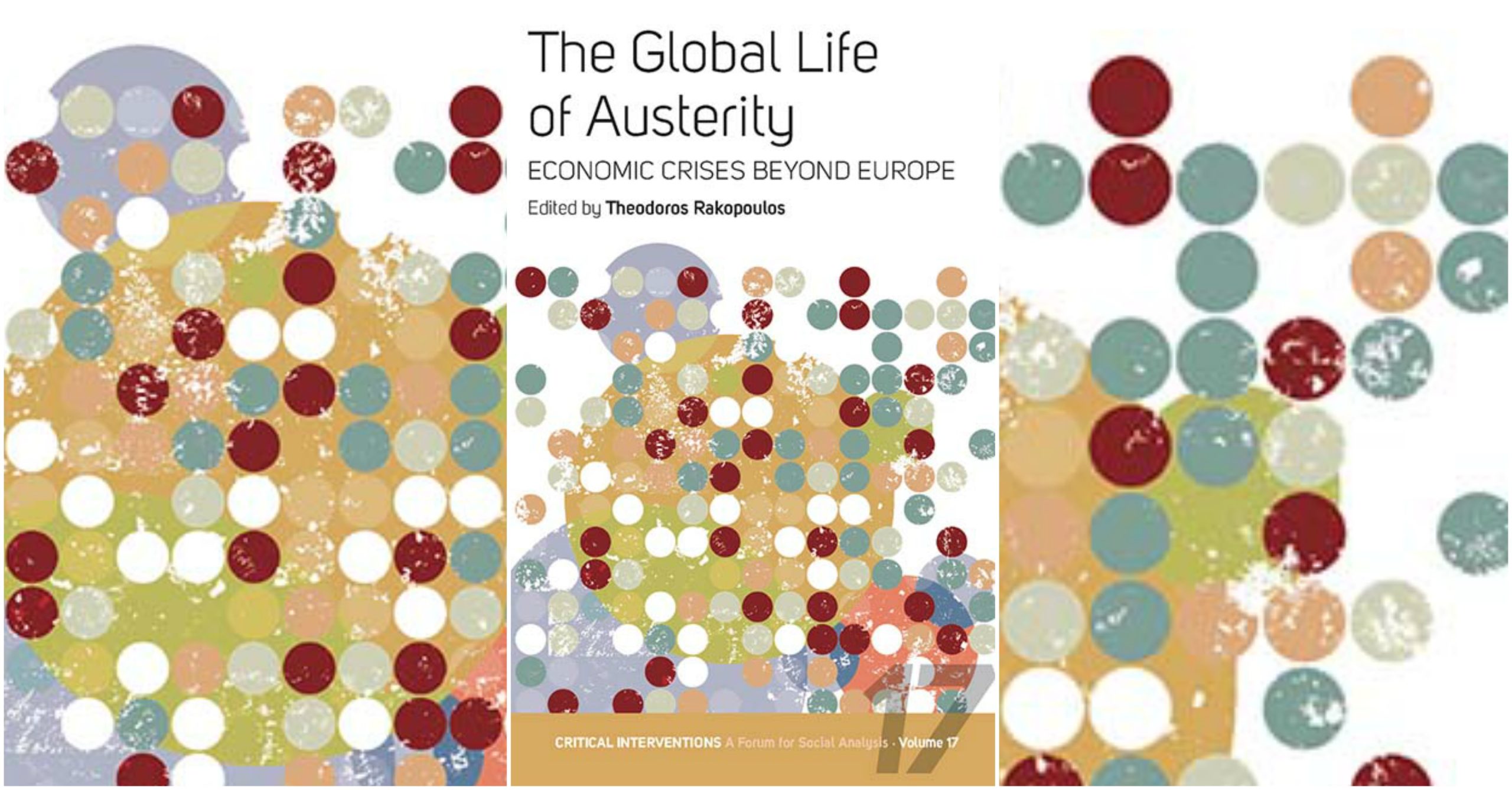
Une grande partie de la recherche anthropologique sur la Grèce s’est souvent centrée sur la prééminence des relations d’ « inégalité symbolique » entre la Grèce et les pays occidentaux, en utilisant des concepts chers aux études « postcoloniales » pour interpréter les politiques d’austérité (par exemple, « eurocentrisme », « orientalisme », « crypto-colonialisme »). D’autres savants pourtant affirment qu’une analyse comparative et historique des crises à l’œuvre nous permettrait au contraire de repérer une logique systémique et universelle des crises économiques et des politiques d’austérité ? Quel est votre point de vue ?
Je répondrai en insistant sur mon axe précédent et en liant cette problématique avec celle de l’ouvrage, qui reflète aussi ma position personnelle sur ce sujet. L’ouvrage collectif «TheGlobal life of austerity» se concentre sur un phénomène particulier d’exercice de politique « néolibérale », qui avant d’être biopolitique ou autre chose, est un phénomène historique qui peut être identifié : le « changement structurel ».
Ce phénomène a toujours été lié à La vie globale de l’austérité: déjà, à partir des crises pétrolières des années 1970. Le changement structurel est un concept qui a été instauré en tant que point de référence politique incontournable en Grèce par Kostas Karamanlis (qui était centriste pour le reste), tandis que les gouvernements de Mitsotakis et de Simitis l’avaient aussi discuté et promu. Il s’agit aussi d’une pratique avancée pendant des décennies en tant que motif « développemental » dans ce qu’on nomme –maladroitement- « reste du monde » (en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord). C’est en Europe, et en fait en Europe du Sud, qu’elle est venue sous la forme d’un concept de type spécial : « austerity », austérité. L’austérité, avec des caractéristiques géographiques et économiques particuliers, demeure un cas spécial de changement structurel appliqué qui est axé surtout sur la politique fiscale. Ce n’est pas une nouveauté : dans le début des années 1990, elle définissait déjà le débat politique en Grèce.
L’ouvrage collectif est une contribution originale car il offre une première présentation de cette grille d’analyse : il compare l’austérité aux programmes de changement structurel sur deux niveaux, en proposant deux choses. Premièrement, du point de vue géographique, il nous rappelle la préhistoire de l’austérité, avec des exemples ethnographiques en dehors de l’Europe, avec des références à des pays tels que l’Argentine, l’Île Maurice, l’Afrique du Sud, et la Corée du Sud. Deuxièmement, d’un point de vue historique mais aussi avec un accent mis sur la généalogie du concept d’ « austérité », on nous rappelle comment il s’est articulé ce concept en Europe : sa préhistoire, soit dans le cas de la Grande Bretagne d’après-guerre, soit en Europe de l’Est suivant l’effondrement du socialisme, mais aussi la vie présente du concept, dans des régions comme la péninsule Ibérienne et la Grèce. L’ouvrage collectif est alors défini par un effort de repousser une logique d’analyse eurocentrique ainsi qu’un effort de reconnecter le débat avec une critique de l’économie politique.

Le centre d’Athènes, Source: Athens Social Atlas.
Pourrait-on affirmer que les interprétations « culturelles » de la crise reproduites ces dernières années dans des discours dominants à l’intérieur de la Grèce mais aussi à l’étranger, ont emprunté au répertoire analytique de l’anthropologie sociale ?
Je crois que ceci est lié à ce qu’on vient de partager. Franchement, j’espère que non. De telles interprétations culturelles sont évidemment très médiocres du point de vue analytique, et il n’y a pas besoin d’être expert pour le saisir. De plus, l’anthropologie offre quelque chose de très positif, l’ethnographe parle avec des gens quotidiens qui vivent la crise et il peut même entendre dans des lieux de travail ou de socialisation des analyses beaucoup plus profondes que d’autres « analyses » écrasantes qu’on lit dans les journaux ou qu’on entend dans des conférences de Presse. Ce qui est important, je crois, c’est qu’en tant que chercheurs en sciences sociales, nous devons écouter attentivement ce que nos interlocuteurs nous disent tout au long de notre enquête de terrain, et observer les nécessités matérielles qui structurent leurs discours et actions. La « pensée locale » ou indigène », telle qu’elle se précise par les récits des agents sociaux ne constitue guère un champ dépourvu de potentiel analytique. Les gens sont généralement suffisamment au courant et tiennent souvent un discours bien informé, et la distance entre le discours scientifique analytique et les narrations « locales » est souvent très courte.

Graffiti de Vassilis Margosian, Athènes (rue M.Alexandrou et Mikinon).
Quel a été l’impact de la crise économique sur les orientations de la recherche anthropologique, en Grèce et à l’étranger ?
En ce qui concerne les tendances dominantes de l’anthropologie anglophone, on assiste beaucoup plus à ce qu’on saurait nommer « réalisme ethnographique » et moins à de discussions théoriques, qui souvent conduisent outre le cadre matériel dans lequel les gens structurent leur vie. La propension à des courants tels que la soi-disant « ontologie », par exemple, indique probablement une certaine insouciance par rapport aux réalités matérielles violentes qui changent nos sociétés. Je me réfère, par exemple, à cette tendance distincte en anthropologie, qui continue – d’une façon tacite – à considérer en tant que thème de recherche et seule contribution de notre discipline la « communauté isolée », où les gens n’ont rien à voir avec ce qu’on appelle « le capitalisme » et ne peuvent même pas le conceptualiser ou le critiquer. Bien sûr, il existe des tendances plus critiques qui, contrairement à une certaine sympathie qu’elles avaient démontrée envers le concept plutôt problématique de la « mondialisation » pendant les années 1990, tiennent aujourd’hui un discours critique. Il conviendrait encore d’effectuer plus de recherches parmi des personnes avec lesquelles les chercheurs ne sont pas d’accord du point de vue politique ou cosmologique : par exemple, des personnes avec des idées racistes et/ou d’extrême droite. J’y tiens particulièrement car, tandis qu’il y a une recherche importante sur les réponses « positives » à la crise, on semble manquer de recherches sur les aspects les plus sombres de telles réponses envers la violence du marché. Polanyi a été le premier à l’affirmer d’ailleurs.
* Entretien accordé à Dimitris Gkintidis
LIRE AUSSI GRECEHEBDO Interview | Georges Prévélakis: La Grèce de la mer comme moteur du renouveau européen, GRECEHEBDO Interview | Noëlle Burgi: L’Europe entre nationalismes et fédéralisme démocratique-social, GRECEHEBDO Débat | D’où vient la crise grecque ?
M.V.



![[VIDEO] Myriam Reyvault d’Allonnes, reparlons de la politique](https://www.grecehebdo.gr/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/alon-420x264.jpg)









