Nikos Smyrnaios est professeur associé à l’Université de Toulouse, membre du Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS), et membre associé au Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Communication, l’Information et la Société (CRICIS) de l’Université de Québec à Montréal. Sa recherche se centre sur l’économie politique de l’internet, les enjeux socio-économiques du numérique, ainsi que l’usage politique des médias sociaux. Grèce Hebdo* et Greek News Agenda se sont entretenus avec lui à l’occasion de la parution en grec aux éditions Metamesonykties et de la présentation à Athènes de son livre “Les GAFAM contre l’internet : Une économie politique du numérique” portant sur la montée en force des compagnies-géants de l’internet (souvent regroupées sous l’acronyme GAFAM) et les implications politiques de cet oligopole.

Votre recherche suggère qu’au cours des trente dernières années certaines grandes compagnies de l’internet et des technologies numériques ont graduellement établi un oligopole. Quelles sont les conditions qui auraient conduit à la montée en force de cet oligopole ?
C’est un long processus. Le projet initial de l’Internet est le produit de conditions historiques et économiques particulières : celles des Trente Glorieuses. Il s’agit bien à l’origine d’un objet financé par l’argent public dans l’optique de l’intérêt général. C’est un idéal-type, mais dans les grandes lignes, il s’agissait de ça. Puis des communautés ont développé le réseau et s’y sont greffées à partir des années 1970 : scientifiques, hackers, et hippies.
Il est important de rappeler que l’infrastructure du réseau a été financée par l’argent public à hauteur de milliards de dollars. Cela va à l’encontre du discours qui veut que seul le marché puisse innover. Même la Silicon Valley est le produit d’investissements publics et le capital risque, qui a permis et permet encore la croissance des start-up, est lui aussi une création du gouvernement américain.
Dans le contexte des années 1980 et 1990 et du triomphe du capitalisme financier dérégulé et du néolibéralisme, on passe à une nouvelle étape de l’histoire du réseau, fondée sur la privatisation, la dérégulation et la financiarisation. C’est le moment où l’idéologie ultralibérale va devenir dominante : on est là aussi face à une question purement politique. Le libéralisme fait la promotion de moins d’Etat, mais c’est l’Etat qui impose les dérégulations et les privatisations.
Il semblerait que selon vous les enjeux sociaux et politiques autour du secteur de l’internet et du numérique sont différents par rapport à d’autres secteurs économiques. En quoi réside cette particularité?
Prenez l’exemple des « fake news » : quand on considère les impacts que cela peut avoir sur la vie publique, économique, politique, on est en droit de considérer que c’est un problème public. Qui doit donc être résolu comme tel en saisissant les citoyens et les institutions démocratiques. Pourtant non. C’est bien Mark Zuckerberg qui indique que Facebook fera ce qu’il faudra pour résoudre le problème. En toute opacité. Est-ce que l’on reconnaît que ces acteurs ont une responsabilité sociale et politique, oui ou non ? Si oui, alors il faut mettre en œuvre des mécanismes de régulation. À l’origine, Internet, l’informatique connectée, étaient pensées comme des services publics. Aujourd’hui ce sont Google et Facebook qui remplissent ces fonctions, sans aucun contrôle démocratique.

Votre ouvrage offre une analyse critique des processus et stratégies économiques qui conditionnent la gestion globale de l’internet aujourd’hui. En même temps, celle-ci ne reflète-t-elle pas aussi une certaine configuration de pouvoir au niveau géopolitique, notamment la dominance des compagnies étatsuniennes ?
En effet, il s’agit d’un oligopole mondial, même si en Chine et en Russie d’autres acteurs existent. Tous les services sont conçus dans la Silicon Valley et vendus dans le monde, sans adaptation aux marchés locaux. Savoir si c’est un capitaliste français ou un capitaliste américain qui stockera mes données personnelles ne changera pas grande chose. Personnellement, le projet d’un Google européen par exemple, ne me semble ni réaliste, ni souhaitable, à moins qu’il adopte des principes de fonctionnement radicalement différents. Pour moi la solution serait d’imposer un contrôle démocratique et une transparence sur la transparence des algorithmes, en créant une instance de régulation indépendante, en faisant de la rétro-ingénierie pour déterminer leur fonctionnement, etc.
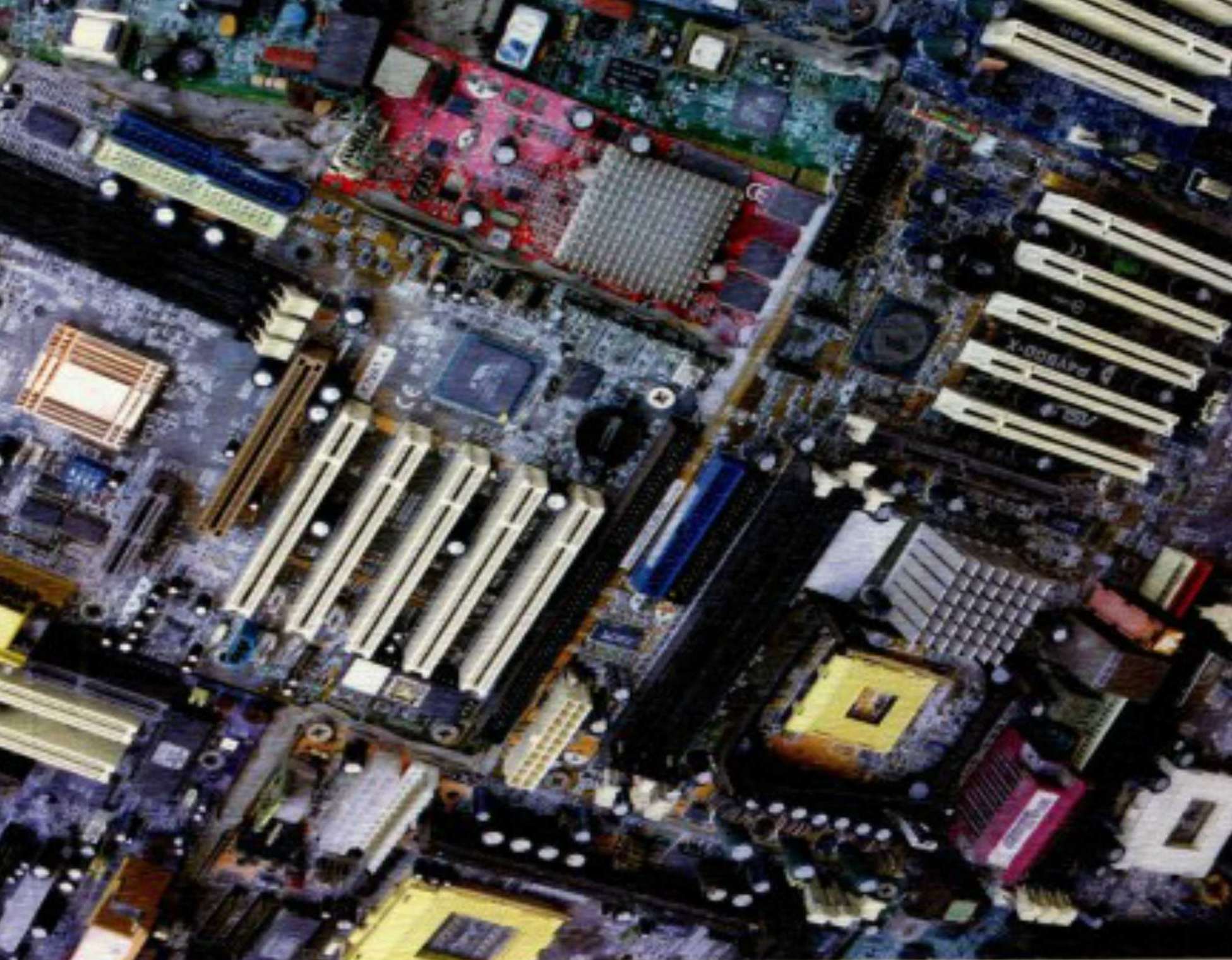
Votre livre opte pour une analyse de longue durée qui met en relief le travail de millions de personnes qui produisent valeur dans le monde numérique, ainsi que les investissements publics qui ont rendu celle-ci possible. Cette perspective ne contredit elle pas des analyses qui mettent souvent en relief l’importance d’individus emblématiques dans le secteur de l’internet ?
L’exploitation du travail des millions d’individus est l’un des facteurs de bénéfices sans précédent des GAFAM. Le taux de rentabilité de Google ou Facebook varie entre 20 et 40 %. La moyenne de Wall Street est à peine à 10 %. Ainsi, en 2018, parmi les six plus grosses capitalisations mondiales, on retrouvait les cinq Gafam. Leur rentabilité s’explique aussi par les nouvelles modalités de travail qu’ils ont réussi à mettre en place. Ils vont dégager des sommes colossales avec très peu d’employés en interne. Les cinq Gafam réunies ont moins d’employés que Volkswagen, et juste un peu plus que Carrefour. Apple arrive à tirer plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires par salarié et par an. Le travail est externalisé chez des sous-traitants de sous-traitants, précarisé, pressurisé, sous-payé à la tâche, au clic. Ils réduisent le travail à des miettes numériques, l’exploitation de l’activité humaine n’a jamais été aussi sophistiquée. D’autant plus que toute une partie de la valeur de Google et de Facebook vient du travail gratuit effectué par leurs utilisateurs. Facebook est vide au départ. Les utilisateurs et éditeurs génèrent de la valeur pour la plateforme sans travailler directement pour elle. Sans coût pour l’entreprise donc. Et en plus tous ces acteurs pratiquent aussi une optimisation fiscale particulièrement agressive.

Evidemment que non. Je ne suis pas technophobe, ni ne suis convaincu que, dans les années 1990, lorsqu’on n’avait qu’une poignée de médias, l’information était meilleure. Mais il faut garder un regard critique. D’autant que l’état d’Internet aujourd’hui n’est pas immuable et reflète un contexte ; à savoir un capitalisme néolibéral hégémonique. Cela peut changer, mais pas sans rapport de forces. Certains signes sont plutôt positifs, le public prend conscience de l’exploitation de ses données personnelles et bloque de plus en plus les publicités. Le monde de la recherche s’y penche aussi davantage. Il serait naïf de croire en revanche en l’émergence d’un nouvel acteur, comme lorsqu’Alta Vista a été remplacé par Google dans les années 1990. On n’en est plus là. Le pouvoir des Gafam aujourd’hui est comparable à celui de l’industrie automobile au XXe siècle. Ils ne vont pas disparaître demain. L’ambiguïté de ce capitalisme numérique est qu’à la fois il va utiliser tout ce qu’il peut pour maximiser ses profits, est extrêmement prédateur et accroît les inégalités, mais en même temps il peut se révéler émancipateur. Le mouvement des Gilets jaunes et même les printemps arabes ou les Indignés n’auraient peut-être pas eu la même ampleur sans les réseaux sociaux. Facebook est avant tout un outil d’exploitation, mais peut aussi servir l’émancipation. C’ est pourquoi il faut insister sur le pouvoir politique des Gafam.
* Propos recueillis par Dimitris Gkintidis | GreceHebdo.gr
A lire aussi: Sissy Alonistiotou: “Media literacy is a fundamental tool for combating bias and hate speech”, Christophe Leclercq, founder of Euractiv, on Europe’s reaction to fake news
TAGS: économie | Médias | politique | technologie











