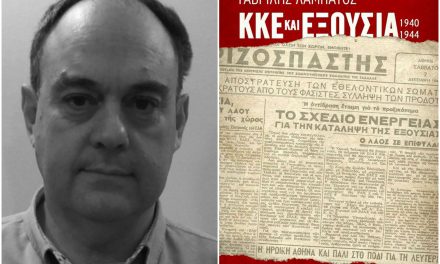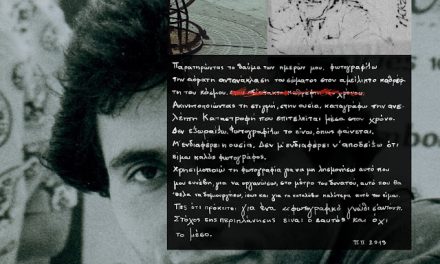Hécate Vergopoulos, Maître de conférences, est chercheur au sein du Gripic, le Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication, du CELSA de l’Université Paris IV-Sorbonne. Après avoir questionné les médiations et les représentations de l’altérité, elle s’intéresse aujourd’hui à la “dysphorie touristique”, soit la fatigue et l’ennui, ou encore la perte de sens à l’épreuve de la pratique touristique. Ses travaux portent sur le tourisme et notamment sur les questions liées à la médiation et à la communication touristiques. Ses recherches s’inscrivent dans le champ des approches communicationnelles et sémiologiques des dispositifs. Elle s’intéresse en particulier aux médiations et aux constructions de l’insolite et de la curiosité à travers les discours touristiques. Grèce Hebdo* s’est entretenu avec Hécate Vergopoulos afin de faire un état de lieu du tourisme, de nos jours.
Dans quel état se trouve le tourisme à l’ère numérique ? Les nouvelles technologies, y compris les médias sociaux, forment aujourd’hui des tendances ?
A mon sens, ce sont plus les médias qui « créent » les tendances touristiques aujourd’hui et la façon dont les mêmes textes (et donc les mêmes idées) circulent finalement en boucle sur Internet ou sur les chaines d’info en continu. On l’a bien vu dans un cas comme celui de la Grèce. Le traitement médiatique de la crise a largement contribué en 2009 à faire baisser la fréquentation française et plus généralement européenne. A partir de 2011, les choses se complexifient quelque peu car c’est la médiatisation du Printemps arabe qui est finalement à l’origine d’un regain de fréquentation en Grèce. En 2012, on filme les manifestations et les émeutes et à nouveau la fréquentation chute. Depuis quelques années cependant, les Grecs ont cessé d’avoir mauvaise presse. En particulier, le vent favorable qui a soufflé sur les gauches européennes et donc Syriza a mis un terme au bashing médiatique du pays. Aujourd’hui, la Grèce est redevenue à ce point « fréquentable » qu’elle cumule les records d’arrivées et que certaines zones du pays connaissent même la saturation touristique.

Aujourd’hui, on assiste à des nouvelles formes de tourisme (tourisme médical/religieux/gastronomique/agritourisme). Est-il possible d’imaginer le tourisme au delà de son caractère en tant que produit industriel à consommer ?
Ce qu’on appelle « le tourisme d’affaires », « le tourisme médical » ou encore « le tourisme religieux » ou « humanitaire » sont des phénomènes intéressants en particulier parce qu’on n’est jamais vraiment sûrs qu’il y soit à chaque fois question de tourisme à proprement parler. Prenons le cas du tourisme médical. Le tourisme nait à partir du moment où l’on invente la curiosité comme mobile valable du voyage, Montaigne étant l’un des premiers penseurs à avoir justement laissé des traces écrites allant dans ce sens. S’ensuit ensuite, au fil des siècles et à mesure que les innovations sociales en faveur du loisir se développent, une industrialisation des procédures de gestion de ces flux d’individus qui se déplacent par désœuvrement. Or, partir loin pour avorter ou congeler des embryons parce que c’est illégal chez soi, se faire poser des implants dentaires au Mexique ou greffer une moustache en Turquie parce que c’est moins cher… tout cela est loin de constituer des parties de plaisir. Certes, voyager pour des raisons médicales peut très bien remplir les critères apparemment « objectifs » qui définissent le tourisme (passer au moins une nuit hors de son lieu de résidence) et même s’inscrire dans la continuité historique des voyages de santé (en stations thermales par exemple). Mais il me semble plutôt que l’enjeu dans le fait de requalifier ces déplacements en pratiques touristiques est précisément d’en favoriser l’industrialisation et de montrer ainsi à quel point elles pèsent économiquement. Pour le dire autrement, le tourisme est par définition une industrie.

A quel point le tourisme est en mesure de transformer l’identité culturelle d’un pays ?
Les anthropologues du tourisme ne cessent de montrer depuis plusieurs années déjà que le tourisme peut participer, dans certaines circonstances, à la folklorisation des cultures. Un cas comme celui de Montmartre à Paris le montre assez bien : afin de jouer la carte de la typicité parisienne, la butte est presque devenue une réserve à stéréotypes (le peintre fauché, le garçon de café à béret, etc.). La folklorisation est le résultat d’un calcul qu’on retrouve par ailleurs dans la société de consommation et qui consiste à se demander « qu’est-ce que je pense que mon consommateur désire ?, qu’est-ce que je pense qu’il s’attend à voir ? ». L’industrie se plie alors en quatre pour montrer aux touristes le spectacle d’une étrangeté déjà familière et domestiquée parce qu’elle fait finalement le pari de la paresse cognitive de ses consommateurs. Pendant plusieurs années, les recherches en anthropologie montraient à quel point cette folklorisation entrait en conflit avec les identités culturelles au niveau local, mais comment finalement elle s’y superposait puis s’y substituait au point que les sociétés finissaient par se retrouver dans les stéréotypes produits par le tourisme et même par les défendre et les revendiquer si besoin. Aujourd’hui, la tendance est différente. Elle consiste à montrer que les acteurs locaux savent très bien faire la différence entre une identité en propre et une identité communicationnelle et marchande construite pour l’autre. Elle va même parfois jusqu’à montrer qu’à l’échelle locale, on sait tellement bien jouer des symboles et des discours que finalement, l’exploité, c’est l’industrie touristique elle-même. Toutes ces approches évidemment sont complexes parce qu’elles rejouent en permanence l’histoire de la domination des peuples et des impérialismes et qu’elles nécessitent d’être toujours réajustées.
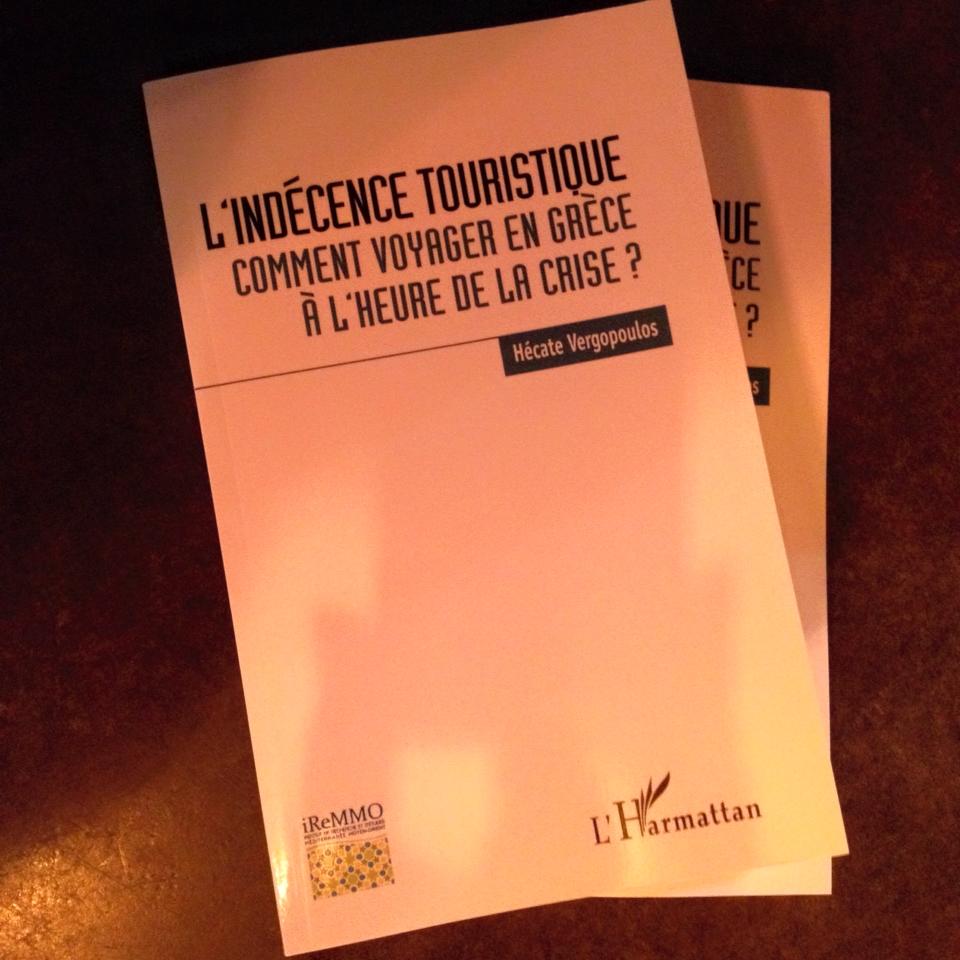
Comment peut-on voyager, en tant que touristes, dans la Grèce de la crise?
C’est la question que je me suis posée et qui est à l’origine de mon ouvrage. On peut la comprendre de plusieurs façons : d’abord au sens moral de « comment peut-on, ne serait-ce qu’avoir l’idée de voyager en Grèce aujourd’hui ? » ; ensuite au sens pragmatique de « comment peut-on, en tant que touristes, naviguer dans un pays rendu à son incertitude ? » ; enfin, et c’est cette voie que j’ai suivie, au sens symbolique de « qu’est-ce que signifie pour soi le fait d’être touriste (donc un consommateur de loisirs) dans un pays meurtri par la crise ? ». Pour tout dire, je ne suis pas à l’origine de cette question. Je l’ai simplement vue se déployer sous différentes formes sensiblement équivalentes à partir de 2012/2013 sur les forums touristiques du web. Je n’ai pas de réponse particulière à fournir et le livre ne prétend pas non plus dire ce qui doit être ou ne doit pas être fait. Je pense seulement que le fait qu’elle soit posée mérite que l’on s’y attarde et qu’on la prenne au sérieux car trop souvent le tourisme est une pratique qui ne se questionne pas à nos échelles individuelles. La crise nous met aussi en face de nos contradictions en tant que consommateurs. Il nous faut prendre le temps d’identifier ces contradictions pour savoir comment, en tant que singularité, on souhaite ou non les assumer.

* Entretien accordé à Maria Oksouzoglou